« RACISÉ·E » - CE QUE LA SOCIÉTÉ FAIT DE NOS CORPS
Il y a des mots qui ne parlent pas de soi, mais de ce que les autres voient. Racisé·e est de ceux-là.

Un mot inconfortable, car il rappelle que l’inégalité ne naît pas dans les différences entre les êtres, mais dans la manière dont elles sont hiérarchisées. Pour saisir toute la portée de ce mot, il faut plonger dans deux notions fondamentales qui en dessinent les contours : la racialisation, qui fabrique la différence ; et la racisation, qui organise la domination.
Racialisation : coller des étiquettes
La racialisation est un processus. Elle désigne la manière dont une société attribue à certaines personnes des caractéristiques, des comportements, voire une « essence », en fonction de leur apparence (couleur de peau, cheveux, nom, accent, etc.) :
Exemple, les noirs ont le rythme dans la peau ou encore les asiatiques sont sournois.
Les catégories raciales qu'on utilise - noirs, arabes, tsiganes, asiatiques - n'ont donc rien à voir avec la biologie :
La couleur noire se retrouve en Afrique jusqu'en Asie du Sud, pourtant elle est majoritairement employée pour désigner les africains
C’est pourquoi on parle de race comme construction sociale. La racialisation peut prendre des formes perçues comme valorisantes ou dévalorisantes : qu’on dise d’un groupe qu’il est naturellement travailleur, ou qu’il serait enclin à la violence, cela reste des étiquettes fondée sur des stéréotypes - c'est de la racialisation.
La racialisation est aussi un phénomène contextuel : selon les pays, les époques ou les groupes sociaux, les catégories raciales ne sont pas les mêmes, et les stéréotypes associés peuvent changer. Une personne perçue comme « noire» en France pourra être perçue différemment au Brésil, aux États-Unis ou en Afrique du Sud. De même, une personne considérée comme « arabe » en Europe pourra être perçue simplement comme « blanche » ailleurs.
Racisation : organiser la domination
Les processus de racialisation ne surgissent pas de nulle part. Ils s’inscrivent dans des histoires longues, profondément liées aux logiques de domination issues de la colonisation. C’est dans ce contexte que la racisation prend place. Le terme « racisé·e » apparaît pour la première fois sous la plume de la sociologue française Colette Guillaumin, qui démontre que la race est non seulement contextuelle, mais aussi profondément relationnelle : on est racisé·e par rapport à une norme dominante blanche.
La racialisation est ainsi un processus de construction sociale qui assigne des identités raciales aux individus. La racisation, elle, est sa traduction politique. Elle consiste à mobiliser ces catégories raciales pour hiérarchiser, exclure et dominer. Cette hiérarchisation s’inscrit dans un continuum colonial, où la construction des races a été créée pour justifier la domination des colonisateurs. À chaque « race » étaient associés des attributs supposés naturels, valorisant les « blancs » et dévalorisant les colonisé·es.

Cette racisation, fondée sur les discriminations, l’exploitation et la violence, reste toujours d’actualité :
l’accès au logement ou à l’emploi plus difficile pour les personnes perçues comme noires, arabes ou roms, ce n’est pas un hasard.
Ces processus ne sont pas figés : ils peuvent évoluer dans le temps, notamment à la faveur d’événements critiques. Un événement critique, c’est un moment ou une série d’événements qui bouleversent les structures sociales et les représentations collectives. Ils peuvent révéler des tensions sous-jacentes ou en créer de nouvelles. Par exemple, les attentats du 11 septembre 2001 ont constitué un tournant mondial : ils ont renforcé la suspicion et l’hostilité envers les personnes perçues comme arabes ou musulmanes, particulièrement en Occident. Ces événements ont intensifié la racisation, la rendant plus visibles, plus violente, plus enracinée.
Dire d’une personne qu’elle est « racisée», ce n’est donc pas parler de son identité intime, mais de la manière dont elle est perçue, construite et traitée socialement en fonction de critères raciaux. Ce marquage repose sur des signes réels ou supposés :
Une personne mexicaine en France peut être perçue comme arabe et subir l’oppression liée à cette assignation. Mais dès que son origine latino-américaine est révélée, le regard porté sur elle change souvent, parfois teinté d’exotisme ou d’une image plus « valorisée » socialement.
Cela illustre combien la racisation repose sur des constructions hiérarchisées, contextuelles et des représentations subjectives, plutôt que sur des réalités objectives ou fixes. Là où l’étiquette « latino » peut être perçue comme valorisante en France, elle est au contraire souvent dévalorisée aux États-Unis, associée à la précarité, à l’illégalité ou à la subalternité.
Et les blanc·hes?
Eux aussi sont racialisés : c’est-à-dire qu’ils sont perçus à travers des représentations sociales liées à leur appartenance supposée à un groupe racial. Ils n’échappent pas aux stéréotypes, qui varient aussi selon les contextes. Mais ces formes de racialisation ne produisent pas les mêmes effets sociaux que celles subies par les personnes racisées.
Être racisé·e, ce n’est pas seulement être vu à travers le prisme de la race : c’est être assigné·e à une position d’infériorité dans l’ordre social. Or, la blanchité continue de fonctionner comme une norme implicite, un repère de neutralité et de légitimité. Même lorsqu’ils sont minoritaires, les personnes perçues comme blanche conservent un accès privilégié aux structures sociales qui les valorisent : emploi, logement, système de santé, école… Iels peuvent subir une forme d’hostilité ou de distance sociale, mais ces stéréotypes ne compromettent pas ce rapport favorable aux institutions.
C’est là toute la différence entre racialisation (processus qui concerne tout le monde) et racisation (processus d’infériorisation structurelle). Les personnes perçues comme blanches sont racialisées, mais pas racisées, car elles ne subissent pas les violences systémiques associées aux rapports sociaux de race.
Déracialiser la société
Alors, faudrait-il déracialiser la société ? À première vue, cela peut sembler être la solution idéale : en faisant disparaître les catégories raciales, on empêcherait la racisation, puisqu’il n’y aurait plus de « races » sociales à assigner ou hiérarchiser. Cette perspective universaliste, souvent défendue au nom de l’égalité républicaine, suppose que le dépassement du racisme passe par l’oubli des différences.
Mais les choses sont loin d’être si simples. Car la race est aussi devenue, pour de nombreuses personnes, une source de reconnaissance, de fierté et de solidarité. Elle permet de nommer des expériences communes, de se reconnaître dans une histoire partagée – souvent marquée par la violence, l’exclusion ou la résistance – et de tisser des liens politiques et affectifs.
Se réapproprier une identité raciale, ce n’est pas essentialiser la race, mais renverser son usage historique : passer d’un outil de domination à un levier d’affirmation, d’organisation collective, voire de guérison. C’est ce que montrent de nombreux mouvements antiracistes ou diasporiques qui, loin de revendiquer l’aveuglement aux couleurs, affirment la nécessité de nommer les rapports de race pour mieux les déconstruire.
La véritable question n’est donc pas tant celle de la disparition immédiate des catégories raciales, mais celle de leur usage : comment les mobiliser sans reproduire la hiérarchie qu’elles ont servi à légitimer ? Et surtout, comment imaginer une société où la race n’aurait plus d’effet structurant, non pas parce qu’on la nie, mais parce qu’on a démantelé les systèmes qui lui donnent son pouvoir ?
Racialisé·e, racisé·e… Ces termes sont avant tout des concepts sociologiques, utilisés dans un cadre scientifique pour analyser les dynamiques sociales liées à la race. Leur emploi suscite cependant de nombreux débats : certain·es les jugent trop réducteurs ou enfermants, tandis que d’autres y voient enfin un langage pour exprimer des réalités longtemps invisibilisées ou inaudibles. Ces perceptions ne disent rien d’essentiel sur les individus, mais beaucoup sur les regards que les sociétés portent sur eux. La racisation, en ce sens, en dit plus sur celui qui regarde que sur celui qui est regardé.
FALL Penda
Bibliothèque
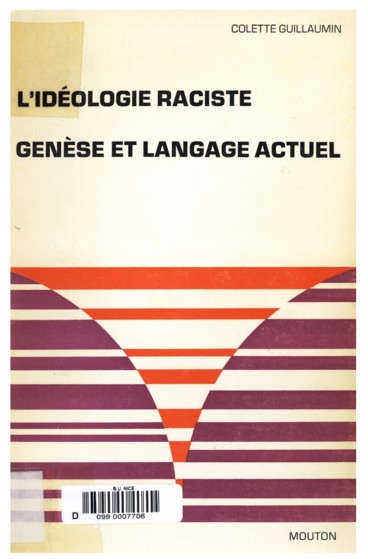
« L'idéologie raciste : Genèse et langage actuel » - Colette Guillaumin, 1974





